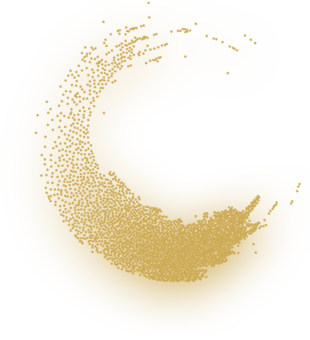Alain Damasio
Coronavigation en air trouble (3/3) : pour des aujourd’huis qui bruissent
« Toute crise majeure est une chance. Parce qu’elle brise un continuum. Et qu’elle ouvre une lucarne dans le mur circulaire de nos habitus cimentés à la résignation et au déni. Une lucarne qui peut vite devenir fenêtre, puis portes sur un futur à désincarcérer. » Épilogue des « coronavigations » : la solution est sans miracle, c’est nous et notre politisation active.
![]() III. POUR DES AUJOURD’HUIS QUI BRUISSENT (ÉPILOGUE POUR L’APRÈS)
III. POUR DES AUJOURD’HUIS QUI BRUISSENT (ÉPILOGUE POUR L’APRÈS)
La promesse d’une fenêtre
Sauf que ça ne repartira pas comme ça. Parce que « on est lààà ! ». Et qu’on veut bien être des lapins apeurés dans les phares du virus, mais qu’il y a une limite ! Et aucune raison que cette pandémie, qui ouvre tellement de possibilités de bouleversements, n’en ouvre pas à ceux qui comme nous veulent changer ce monde.
Toute crise majeure est une chance. Parce qu’elle brise un continuum. Et qu’elle ouvre une lucarne dans le mur circulaire de nos habitus cimentés à la résignation et au déni. Une lucarne qui peut vite devenir fenêtre, puis portes sur un futur à désincarcérer.
Cette pandémie n’est donc pas qu’une catastrophe.
C’est déjà beaucoup plus, beaucoup mieux : une promesse. Une promesse pour le printemps qui vient et dont nous pouvons être les bourgeons têtus, les fleurs sans naïveté et les fruits qui mûrissent.
Je ne sais pas si « rien ne sera plus comme avant » après le confinement, comme lancent ces oracles dont les prophéties se voudraient auto-réalisatrices. Mais pourtant quelque chose se fend. Indiscutablement. Une brèche. Tentons d’y passer une main.
D’abord confiner le plasma radioactif du capital
Bruno Latour parle joliment de gestes barrières pour contrer (après le confinement) le capitalisme extractiviste et ses massacres écocides. L’image qui me vient est plus SF : comment, une fois la pandémie passée, parvenir à confiner, à notre tour, ce plasma radioactif du capital-en-nous, qui a fini par nous irradier tous — et qui voudra continuer à le faire ?
Il ne sert à rien de se prétendre contre le capitalisme. Demandez aux gens, tout le monde est contre : toutcontre. Il ne sert à rien de se croire au dehors : la marge appartient encore au système et l’alimente même plus puissamment que son centre. La vérité est plus cruelle : si le capitalisme est si présent, s’il infiltre partout ses liquides, s’il démultiplie de façon fractale ses logiques jusqu’aux secteurs qui avaient su longtemps le repousser (l’éducation, la santé, l’humanitaire, l’amitié, la militance, l’art…), c’est parce qu’il prend en nous son énergie. On l’irrigue avec notre sang ; on l’électrise avec nos nerfs ; on le rend intelligent avec nos cerveaux. Il nous manipule avec nos propres mains.
Barbara Stiegler encore : « le néolibéralisme n’est pas seulement dans les grandes entreprises, sur les places financières et sur les marchés. Il est d’abord en nous, et dans nos minuscules manières de vivre qu’il a progressivement transformées ».
Il faudra un jour cesser de concevoir nos ennemis comme extérieurs à nous. Et ne jamais oublier qu’une partie du combat que nous devons mener se joue entre soi et soi. Toutes nos servitudes sont volontaires, si l’on y regarde bien. L’appât du fric et le bonheur de consommer nous traversent toujours, à un moment ou à un autre. Font conduction en nous. Les addictions numériques qui nous piègent sont d’abord des auto-aliénations que nous activons et subissons nous-mêmes, pulsions et paresses, plaisir et souffrances mêlées.
Pour cette crise, d’ailleurs, qui est pour l’instant le grand vainqueur du confinement, sinon ceux dont le projet est de virtualiser le monde ? Qui, sinon ces quatre bases nucléiques de notre Acide DésoxyriboNumérique : G, A, F, A ? Quand vous logez, au sens policier, trois milliards d’individus dans leur grain de maison, côte à côte, bloqués dans leurs monades urbaines, lovés dans leur technococon, qui tisse la chrysalide ? Qui forme la rafle, cette tige qui articule les grains de raisons sur la grappe ?
Ah oui, là, on rigole moins. Là, on ne clique plus sur la bannière, on ne forwarde plus son neuvième mème de la journée, on stoppe net le scrollytelling de la propagation sur des magnifiques cartes pointillistes élaborées par tracking téléphonique… On se pose. On sort un peu !
La solution est sans miracle : c’est nous et notre politisation active. Il faudra finir par l’entendre. Que ça ne nous empêche pas de manifester, d’occuper, de combattre et d’agir contre ce gouvernement. Mais en visant un point au-delà de la brique qu’on casse.
De quelques attitudes mentales propices
Dans cette pandémie, il y a ce que le virus nous fait. Ce que les gouvernements font de ce virus.
Et il y a ce que nous ferons de ce que nos gouvernements nous font.
Si je devais suggérer une attitude mentale qui me semble féconde pour construire le pendant et l’après, je dirais ça (et merci à cet article si down-to-earth et si pertinent de Pouhiou que j’ai découvert sur le framablog et que je retrempe ici à ma sauce : « Il n’y a pas de solution, il n’y a que nous »)
- Si j’arrête de croire qu’une institution le fera pour moi, je peux agir sur le petit bout d’univers qui se trouve autour de moi ;
- Si je trouve des gens avec qui je suis bien, on peut l’agrandir ensemble, progressivement, ce petit bout d’univers qu’on se sent capable de changer.
- Si on écoute les vécus, apprend des expériences et reprend les pratiques de ceux qui font des choses qui marchent en dehors des institutions, ça va roxxer. Tout seul, on va plus vite, mais ensemble on va plus loin.
En vérité, la direction à prendre est une pente naturelle — mais qui s’aborde en montant. Tout sauf la plus facile, donc. C’est la pente que vous voyez à gauche, sur la colline, celle où il faut…
…te sortir les doigts pour te battre, créer, monter des projets en dépit et même contre ceux qui décident dans un bureau depuis un siècle quels projets devraient être montés.
…nous remonter les manches pour prendre en charge directement ce que personne d’autre ne fera mieux que nous parce que nous sommes là où ça se passe, où nous savons quoi et comment le faire. Pas eux, pas l’État, pas le conseiller, pas l’entreprise X.
… nous prendre le chou à essayer de faire attention à tous les problèmes, à toutes les personnes, tout en sachant très bien qu’on n’y arrivera pas, jamais parfaitement.
…comprendre que la pente zigzague, qu’il n’y a pas de raccourci miracle, pas d’appli qui sauve le monde et ton cul. Pas de solution magique donc, juste notre joie et notre fierté de faire le chemin ensemble, de l’inventer à mesure. Et donc de rater, tenter, rater encore, rater mieux !
Comme le dit à sa façon Pouhiou, « c’est pas une solution, hein : c’est une route. On va trébucher, on va se paumer et on va fatiguer. Mais avec un peu de jugeote, on peut cheminer en bonne compagnie, réaliser bien plus et aller un peu plus loin que les ignares qui se prennent pour des puissants. »
Donc première attitude : ne plus croire que le gouvernement le fera pour nous. Yes, he can, quand il le veut vraiment. Oui on peut le contraindre, un peu, mais ça fait 40 ans qu’on jette des palettes sous les chenilles du bulldozer néolibéral sans le ralentir beaucoup, n’est-ce pas ?
Ne rien attendre de lui. Qu’il ferme juste enfin sa grande gueule quand il dit qu’il n’y a pas d’argent magique, ce serait déjà énorme. De l’argent « magique », il y en a. Ça s’appelle prélever des impôts à ceux qui éjaculent du fric. Prenez juste 99 milliards à Bernard Arnault, première fortune mondiale, et laissez-lui en 1, en pourboire. Ça s’appelle parfois aussi la planche à billets. Ça s’appelle encore une relance keynésienne. Ça s’appelle payer des salariés du service public plutôt que donner des subventions aux sociétés cotées en bourse qui vont les transformer aussitôt en dividendes et enrichir encore plus les déjà-trop-riches.
Et ça s’appelle aussi sortir de la marchandisation de tout. Rien ne les détruit plus que le gratuit ! Et qui l’a mieux exprimé qu’Édouard Glissant, Patrick Chamoiseau et leurs amis en 2009 ?
« Voici ce premier panier que nous apportons à toutes les tables de négociations et à leurs prolongements : que le principe de gratuité soit posé pour tout ce qui permet un dégagement des chaînes, une amplification de l’imaginaire, une stimulation des facultés cognitives, une mise en créativité de tous, un déboulé sans manmande l’esprit. Que ce principe balise les chemins vers le livre, les contes, le théâtre, la musique, la danse, les arts visuels, l’artisanat, la culture et l’agriculture... Qu’il soit inscrit au porche des maternelles, des écoles, des lycées et collèges, des universités et de tous les lieux de connaissance et de formation... Qu’il ouvre à des usages créateurs des technologies neuves et du cyberespace. Qu’il favorise tout ce qui permet d’entrer en Relation (rencontres, contacts, coopérations, interactions, errances qui orientent) avec les virtualités imprévisibles du Tout-Monde... C’est le gratuit en son principe qui permettra aux politiques sociales et culturelles publiques de déterminer l’ampleur des exceptions. C’est à partir de ce principe que nous devrons imaginer des échelles non marchandes allant du totalement gratuit à la participation réduite ou symbolique, du financement public au financement individuel et volontaire... C’est le gratuit en son principe qui devrait s’installer aux fondements de nos sociétés neuves et de nos solidarités imaginantes... ».
Ce qu’on mérite ?
Je ne crois pas qu’on puisse « décider » à l’échelle d’une nation, d’une expérience commune aussi cruciale que la crise du coronavirus et ce qu’elle nous fait.
Pourtant, est-ce que notre monde social et vivant ne mériterait pas ça ? Je veux dire : ne mériterait pas, disons, qu’on consacre deux mois de son existence à éprouver enfin ce que serait un monde de prospérité sobre ? Un monde de croissance ? Allez, osons nous réapproprier le mot, oui : de croissance de nos disponibilités, de notre attention aux autres, de croissance de nos bienveillances mutuelles. De croissance de nos lenteurs riches. De poussée du réensauvagement de nos espaces trop urbanisés.
Un monde de technologies douces, réparables et recyclables, intelligemment contenues, de buen vivir où l’on mangerait mieux, local et savoureux, consommerait le strict nécessaire, éliminerait enfin les métiers parasites (pub, marketing, com, finance…) et les jobs de merde pointés par Graeber : courtier, larbin, lobbyiste, petits chefs, vigiles… Où l’on prendrait conscience aiguë que les biens nous ont « eus » quand ce sont les liens qui devraient nous guider. Les liens à nos proches, familles et amis, tout autant qu’à l’étranger qu’on découvre, au migrant qu’on accueille, qui sont juste comme nous, qui sont nous. Les liens à renouer avec le vivant, biotopes, animaux et végétaux, champignons et bactéries, et même ce lien… au virus !
Aucune de ces formes n’est notre ennemi ni ne le sera jamais. Car ces bactéries nous constituent et nous soignent, forment notre microbiote ; ces virus nous mutent, et nous construisent en modifiant nos ADN. 700 000 types différents circulent en permanence dans nos corps. Les virus naissent, passent, disparaissent. Ils n’exigent aucune guerre, juste l’attention juste au juste moment — mais c’est déjà trop pour un capitalisme rivé à ses courses de bites et à ses cours de bourse.
Dans cette crise, de très nombreuses actions locales, initiées par des personnels hospitaliers, des laboratoires vétérinaires, des petits industriels, des militants de toute sorte et de tout métier ont fleuri, avec intelligence, célérité et pertinence. Depuis des semaines, nous avons sous les yeux et à l’échelle d’un pays la preuve quotidienne qu’une organisation verticale centralisée est obsolète dans une société éduquée aux ramifications complexes. Bonne nouvelle pour nous tous — et péril fatal pour la petite caste prédatrice qui voudra maintenir, "à n’importe quel coût" son pouvoir, fut-il seulement celui de nous nuire.
Puisque l’étoffe des nouveaux mondes se trame déjà, tissons-nous à eux !
Vouloir viser un retournement national est la meilleure façon de s’impuissanter. C’est comme ça que sporule la militance triste qui échoue partout et ne gagne plus aucun combat. Alors qu’en acceptant de changer d’échelle, de partir de là où l’on est, où l’on vit, où l’on lutte, de nos tissus fluents de liens déjà actifs, on peut parvenir à mobiliser avec une vraie focale et une vraie force des communautés affines avec nos combats et motivées.
Ce qu’on peut décider, raisonnablement, c’est de « covider » localement nos productivismes et de se donner les moyens d’une expérience partagée des disponibilités que la pandémie nous a offert malgré elle. Dans mon roman Les Furtifs, j’appelle ça créer des ZAG (zones auto-gouvernées) ou des ZOUAVES (zone où apprivoiser le vivant ensemble). Peu importe le nom et son humour potache.
Ce qui importe est de sortir du confinement capitaliste et de nous ménager des dehors où respirer, réinventer et retisser. Territoires où expérimenter. Temps libérés. Collectif où lier & relier.
La bonne nouvelle est que germent déjà de partout (quoiqu’on dise, et étouffe, et fasse croire) d’innombrables initiatives en ce sens.
Il n’y a plus de lendemains qui chantent, et c’est tant mieux. Mais il y a des aujourd’huis qui bruissent. Et c’est mieux.
Ces initiatives, à l’instar des ZAD et des gilets jaunes, qui sont la portion médiatisée de l’iceberg, ont ceci de commun qu’elles refusent les hiérarchies, le culte des chefs, le patriarcat. Elles se foutent de consommer, de « faire de l’argent », de prendre le pouvoir. Elles préfèrent enfanter dans la couleur que dans la douleur — même si elles encaissent leur lot de souffrances.
Elles prônent une politique du vivant qui fond luttes sociales et écologiques dans un même alliage incandescent. Une politique fondée sur l’écoute et l’accueil de ce qui n’est pas (encore) nous ; qui considère que tout ce qui porte atteinte au vivant nous porte atteinte à terme. Qui ne croit plus que l’indépendance soit la source de toute liberté mais plutôt que ce sont les interdépendances acceptées qui nous ouvrent un monde plus fécond et au final nous émancipent mieux.
De fait, ces initiatives sont ouvertes : l’inverse de communautés fermées ou d’ilôts repliés et fiers. Quand elles naissent, elles ont la forme rhizomatique d’un mycelium qui tend partout ses fils et ses hyphes et espère qu’on s’y attache, qu’on en fasse nœuds ou qu’on les prolonge. Ce sont des appels. Ces initiatives n’entendent pas être une nouvelle norme sociale mais juste de nouvelles formes du bien-vivre ensemble.
Si le Covid peut servir à quelque chose de positif, c’est en nous faisant sentir que c’est vers ces projets et ces pratiques qu’on doit se tourner. C’est avec elles qu’on doit faire pièce et mosaïque mouvante, plutôt que de lancer un énième « projet politique » prétendûment rassembleur — qui sera vite excluant. Comme le suggère Corinne Morel Darleux, l’époque est aux archipels.
Pas la peine de réinventer la roue : la roue, les roues existent déjà, un peu partout. Roue libre ou roue de secours, roue de vélo et deux-roues, petite roue, grande roue et roue de la fortune, roue en bois, en fer, motrice ou directrice, crevée ou surgonflée, sans pneu ou sans jante, elles ne nous ont pas attendu pour avancer mais elles nous espèrent pour continuer à rouler et faire le chemin avec nous. Toi tu pourras faire rayon, toi le moyeu, toi façonner la gomme d’un pneu et toi consolider une jante. Ensemble on tirera des essieux, y articulera des cardans, nous forgerons un bas de caisse. Ensemble nous réfléchirons au moteur, aux pistons, discuterons des carburants possibles et de la nécessité d’un volant. Ou déciderons qu’une chaîne, un guidon et des mollets suffisent. Ou que les plus belles roues sont en fromage, sont une raclette à partager.
Face à toutes ces associations, ces collectifs citoyens ou radicaux, ces initiatives, ces SCOP, ces ZAD, ces ateliers paysans, ces hackerspaces, ces pôles d’éducation populaire, ces groupes libres qui font déjà, aident à mieux vivre et construisent les rapport sociaux de maintenant et l’écologie de demain, nul besoin d’autre chose que d’ouvrir les yeux, tendre ses propres fils et s’emberlificoter joyeusement.
Ceux qui pensent que l’État est à la fois le problème et la solution n’ont jamais ouvert un livre d’anthropologie ni vu un documentaire ethno. Il suffit pourtant de jeter un œil sur d’autres cultures et d’autres temps. Les sociétés sans État existent, ont existé et existeront. Elles ont prouvé leur pluralité et leur viabilité. Bien avant nous.
L’État peut rester un outil et un horizon s’il devient un État souple : c’est-à-dire capable d’accepter que des communautés et que des « sociétés sans état » se déploient sur « son » territoire. Qu’en son sein et hors de son sein coule un lait différent. Que d’autres mondes, d’autres cosmos locaux soient possibles et articulés à lui, qui peut rester une sorte de coordinateur des communs, à leur exclusif service : on aura sans doute toujours besoin d’une sécurité sociale, d’un accès universel à l’eau et à la nourriture, comme d’une santé et d’une éducation commune.
Ça ne doit pas empêcher d’expérimenter d’autres façons de faire, vieilles comme le monde ou fraîches comme des touffes de sphaigne qui poussent.
Salut à vous, ami.es des Confins !
Voir en ligne : Retrouvez ce texte sur le site Médiapart