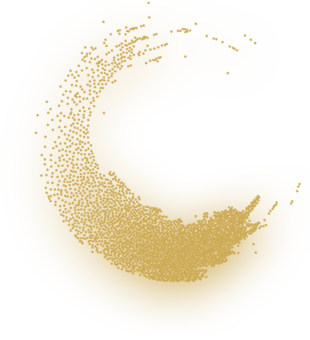Le Vent se lève : Anne Théron et Tiago Rodrigues réinventent Iphigénie

Photo : Jean-Louis Fernandez
Au dernier Festival d’Avignon, Anne Théron créait la version réécrite par Tiago Rodrigues d’Iphigénie. Les femmes y défient le Destin comme les fables divines qui peuplent nos souvenirs et figent un avenir tragique.
Rebattre le mythe. Défier la mémoire et l’immuable. S’élever contre une lutte qui serait perdue d’avance, de celles que la tragédie fige dans le temps jusqu’à nous cerner de fatalisme et prendre en otage perpétuel l’imaginaire des possibles. Si Tiago Rodrigues suit tel un palimpseste la trame d’Euripide, il ose le pas de côté pour mieux nous rapprocher de ce qui s’y joue. Depuis le Ve siècle avant J.-C., la malédiction touchant les Atrides conte un cycle sans fin de vengeances et de violences gangrénant l’exercice du pouvoir.
La mythologie se fait implacable avec Iphigénie, fille du roi Agamemnon et de Clytemnestre. Lors de la guerre de Troie, l’oracle prédit que seul son sacrifice à Artémis permettra de convaincre la déesse de laisser souffler les vents contraires qui permettront à la flotte hellène de quitter Aulis pour aller venger l’affront fait au royaume : Hélène a quitté Ménélas, frère du souverain, pour suivre le beau Pâris chez leurs ennemis.
Avec la poésie qu’on lui connaît, l’auteur portugais confronte les protagonistes à leurs souvenirs dans un présent où se rejouerait – dans leur conscience ou leur cauchemar ? – le fil d’une histoire dont seules certaines voudraient véritablement changer la fin. Avec le concours subtil du chorégraphe Thierry Thieû Niang, Anne Théron crée un chœur de femmes en colère contre l’histoire dont elles se souviennent envers et contre tous. En colère de voir les hommes venir de la Grèce entière pour sauver une femme malgré son choix. De les voir tous marcher au storytelling du rapt.
Devant une toile où se projettent des flots irisés par le reflet de la lune, chacun chemine avec sa mémoire de l’avenir, avançant comme des pions dans une partie d’échecs, isolés les uns des autres dans une scénographie qui se fracture en îlots de sombres artefacts rocheux. L’anaphore « Je me souviens » accentue la plongée dans les sentiments, les remords d’Agamemnon (Vincent Dissez au bord des larmes, en conflit intime permanent et pourtant inexorable), l’impossible renoncement d’une Clytemnestre brisée à l’intérieur mais lucide, jouée dans un mélange de rage froide et de puissante vision politique par une Mireille Herbstmeyer étincelante.
Elle questionne la légitimité même de la guerre face aux fourberies et à l’éloquence d’Ulysse, loin de l’image lisse qu’on lui accole trop souvent. Si « les dieux sont des fables qu’on nous raconte pour nous souvenir autrement de ce qui s’est réellement passé », une fille sera bien sacrifiée pour du vent. Sur fond de bruit des vagues se fracassant sur le rivage, de ciel tempétueux, le chœur danse tout en saccades, les bras levés au ciel, embrassant en rond l’espace, se débattant pour ne pas sombrer. Sa féroce vérité interroge le libre arbitre et la force des choix individuels, pointe la résignation et l’abandon, que la posture insoumise d’Iphigénie, refusant ce monde de mensonges, oblige à regarder en face.
Thomas Flagel - Magazine Poly - 29 septembre 2022
Voir en ligne : Retrouvez cet article sur le site du Magazine Poly