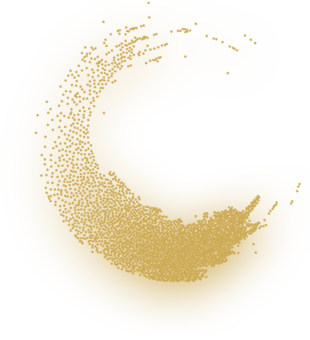Sabine Prokhoris
Les raisins verts
« On n’est plus soi-même, dans ces conditions, et c’est pénible de ne plus être soi-même, encore plus pénible que de l’être, quoi qu’on en dise. Car lorsqu’on l’est on sait ce qu’on a à faire, pour l’être moins, tandis que lorsqu’on ne l’est plus, on est n’importe qui, plus moyen de s’estomper. Ce qu’on appelle l’amour c’est l’exil, avec de temps en temps une carte postale du pays, voilà mon sentiment ce soir. » Ce n’est pas Shakespeare, c’est Samuel Beckett. Shakespeare transformé, dirait-on.
Dix-huit jeunes hommes et jeunes femmes – dix-huit jeunes acteurs –, corps conducteurs du trouble de l’amour. Métamorphose continue, paroles s’envolant en volutes dansantes, bal des mots et des corps : « L’amour est une occupation de l’espace » (Henri Michaux). Comme l’air, comme l’eau, comme les paroles. Il se répand, il court, rebondit d’une vie à l’autre, d’une voix à l’autre, tel le vent ; il noue, dénoue, emmêle, les vies les unes aux autres. Dans la proposition d’Anne Alvaro et de Thierry Thieû Niang, fruit d’un atelier avec les élèves du Conservatoire Nationale d’Art Dramatique, cela passe par les mots de Shakespeare, grâce et intelligence poétiques qui parcourent comme une onde ces présences frémissantes, dont pas une ne « trouve moyen de s’estomper », ayant accepté cette donne-là : ouverte au passage, pouvoir devenir n’importe qui. La magie théâtrale même. « Le monde entier est un théâtre, et tous, hommes, femmes, ne sont que des acteurs. Ils ont leurs entrées, ils ont leurs sorties. » (Comme il vous plaira) Ils passent, donc. Et par eux, par chacun d’eux singulièrement, passe l’énergie de vivre, démultipliée à l’infini de leurs métamorphoses possibles.
La question de l’amour, de ses vicissitudes – l’amour qui toujours nous met dans tous nos états, et dans bien d’autres encore !, ce que les mots de Shakespeare disent de tant et tant de façons –, est donc celle même du théâtre, espace ouvert au devenir autre que « soi ». Espace de perpétuelle et imprévisible transformation, comme l’est celui des songes : zone intense, tumultueuse, où se fomentent d’improbables hybridations, contrée évanouissante autant que captivante ; creuset brûlant de la plus grande intimité, qui manifeste aussi, sans cesse, l’étrangèreté même, l’inconnu, le non encore advenu. Matière instable et infiniment diverse que la Reine Mab verse au creux de la nuit, dans l’abandon au sommeil, le monde entier, et d’innombrables mondes, dans chaque âme résonnante, « puisque le monde est la population d’un rêve. » Comment mieux dire que ne le fait Shakespeare, rendu à sa vivacité actuelle par les voix qui nous le donnèrent à entendre ici et maintenant un soir de novembre 2014, que la réalité, ce que nous partageons, et transmettons, est ce que nous ne cessons, chacun, de réinventer, seuls et ensemble ? C’est bien pourquoi le théâtre, le jeu théâtral, est chose si vitale, si élucidante, et potentiellement aussi si libératrice. Le théâtre, ce voyage vers l’univers habité à travers des espaces et des espaces de solitude et d’insensé ; le théâtre, autre nom de l’amour : « Car plus la poésie est vraie, plus elle est fausse ; et les amoureux sont fort adonnés à la poésie. » (Comme il vous plaira) C’est-à-dire qu’ils portent en eux une énergie, électrique, de transformation du réel. Non pour le fuir, mais pour y tracer de nouvelles pistes, poèmes fous sur l’écorce des arbres, aux pieds bancals peut-être, mais alors les forêts pourront, miracle, se mettre en marche – souvenons-nous de cette autre forêt, la forêt de Birnam dans Macbeth – et renverser les tyrannies. Alors Michaux, encore : « Sincère ? J’écris afin que ce qui était vrai ne soit plus vrai. Prison montrée n’est plus une prison. » Et l’on pourra alors cheminer dans les forêts les plus obscures, les plus cruelles, les plus enchevêtrées de ronces. Y croiser, peut-être, quelques-uns de ces « animaux purs que l’homme n’effraie pas », comme l’écrit Paul Éluard dans un poème d’amour.
La forêt, justement. Espace même, pluriel, de la métamorphose, chez Shakespeare, zone commune, ambiguë, violente et douce à la fois, du civilisé et de la sauvagerie. Espace ombreux de palpitations mystérieuses, où tout est devenir, où tout peut advenir. La magie de la proposition théâtrale d’Anne Alvaro et de Thierry Thieû Niang, magnifiquement portée par ses dix-huit interprètes, réside sans doute dans le parti qu’ils ont pris, éminemment poétique, de faire interpréter la forêt, ce personnage pluriel, polyphonique, choral, version en somme du chœur des comédies et tragédies grecques, par les acteurs eux-mêmes. L’inoubliable et tendre image de la fin du spectacle, lorsque les filles, sous nos yeux émerveillés, habillent en arbres les garçons, au moyen de quelques branchages qui légèrement ondulent, comme sous une brise, au gré de la respiration, des imperceptibles mouvements des corps au repos déployés dans l’espace entier du plateau, cette image se lève comme l’image même, frémissante, de la représentation tout entière. Car la force et le pari de cette mise en scène, c’est-à-dire en espace, et en corps, de la poésie shakespearienne, tient à ceci que nul ne se retrouve enclos en toute sécurité dans un « rôle » bien délimité. Les mots au contraire, et les scènes, vont circulant de bouche en bouche, de corps en corps, passant de loin en loin par de fugitifs unissons, le tout inventant sans cesse une rythmique ouverte, fluide, métamorphique, qui incarne, au singulier pluriel, la transformation même, foncièrement inquiète. Naît alors cet espace/corps fluide et moiré, « l’étoffe de nos rêves » (La Tempête), qui nous fait et nous défait, et dont les dix-huit jeunes gens aventurés dans ce voyage aux multiples tours et détours nous offrent une version de bout en bout vibratile.
L’amour. Le théâtre. C’est du pareil au même. Et du pareil au même, l’écart, infiniment mobile, de l’« espace entre » intimement tissé des uns aux autres, dit et effectue la métamorphose même, en son impulsion la plus secrète. Secrète oui, car comme le savaient déjà les Grecs dont les dieux ne cessaient de jouer à se transformer, à devenir – pour séduire ou s’échapper –, autre chose, l’on ne peut jamais saisir la teneur exacte de ce mouvement d’apparition agissant au cœur de la disparition même, qui ne cesse de reconduire autrement, de retraduire, de réinterpréter toute chose. Alain Cavalier a capté cela de la plus poétique, de la plus simple, de la plus profondément enfantine des façons, dans Le Paradis, où l’on voit un bout d’écorce, justement – la forêt, encore –, se muer sous notre regard enchanté en diable ou diablesse, et Athéna rire de ses transformations en chouette.
Au cœur de la pièce – puisque cet admirable montage de textes, tout en résonances, cette puissante et subtile lecture de Shakespeare sous un certain angle, fait au bout du compte une pièce –, une scène rieuse et vive, légère comme l’écume des vagues, d’abord interprétée par deux jeunes femmes – dont l’une joue Rosalinde travestie en garçon dans Comme il vous plaira – sera immédiatement après réinterprétée par deux garçons – qui jouent alors les deux jeunes filles. Moment miraculeux, car par cette réinterprétation de la même scène, la sensation de métamorphose, est alors portée à son comble. Vertige. Du vertige de l’amour, il aura été question un peu plus tôt, de ce tournis, de ce tourbillon, parlé/dansé en contaminations courant de proche en proche, se répandant/se répondant tout alentour, une « valse infinie », comme dit la chanson. Tout est pareil, tout tourne alors à quelque chose d’entièrement différent. Répétition créatrice, recréatrice, spirale ouvrant sur l’illimité des tonalités où ce « même » peut muter, immensément se modifier en sa réitération ailleurs. N’est-ce pas cela même, toujours plus obstinément creusé, de soir en soir et d’interprète en interprète, le jeu de l’acteur ? Cette fugue sans début ni fin, cette musique ?
Adresse s’il en est au spectateur/interprète, que ce redoublement qui opère la plus inattendue, la plus généreuse, la plus inventive des altérations. Le spectateur lui aussi errant et cherchant dans la forêt, lui aussi, en sa situation singulière, pris dans les courants venteux qui circulent entre tous. Car chaque regard est aussi une réinterprétation où tout se remet en jeu, se renouvelle, et renaît autrement ; une zone de passage et de bifurcation intensive de ce qui est transmis dans et par le moment théâtral. Chaque regard est – peut devenir – une forêt aux mille et un « sentiers qui bifurquent. » (J.-L. Borgès)
Alors, encore, l’amour, le théâtre – la vie, frémissante, les choses captées à l’état naissant, le « chaos irisé » qu’évoque Paul Cézanne.
Et les raisins (verts), à la rencontre des lèvres qui s’ouvrent (Comme il vous plaira) – pour laisser, après tout, le dernier mot au fou plein d’esprit de Comme il vous plaira. Le fou qui sait et ne sait pas que ipse – ce « soi-même » (« qui » m’aime ?) bien aimé – passe de corps en corps. Ce coup-ci, dans l’amour, ipse, ce sera son tour… [acte V, scène 1] Alors l’on pourra, sans trop de crainte, devenir n’importe qui. Aimer en somme. Et goûter les raisins…