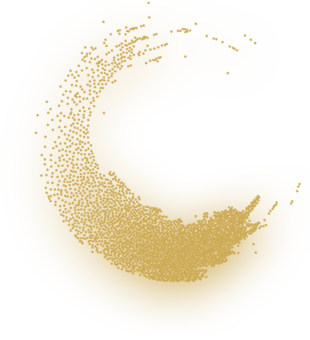Pascal Rambert : « Pour moi le mur de la Cour d’honneur c’est un ready-made »

Photo : Vanessa Rabade
Jusqu’au 13 juillet, Pascal Rambert met en scène Architecture dans la Cour d’Honneur du Palais des Papes. La pièce qui a ouvert le Festival d’Avignon divise par sa modernité. Nous avons eu envie de le faire parler, encore un peu plus, de la construction de ce spectacle. Rencontre.
![]() Je n’avais pas vu depuis longtemps un metteur en scène faire parler le mur de la sorte.
Je n’avais pas vu depuis longtemps un metteur en scène faire parler le mur de la sorte.
C’est intéressant parce que c’est une chose qui a été longtemps en question… Tout ce que je fais ce sont toujours des sols blancs. C’est quelque chose que j’ai commencé à faire en travaillant dans le champ chorégraphique. J’ai mis des tapis de sol blancs et je les ai gardés pour le théâtre parce que c’est ce qui donne selon moi la meilleure définition d’un corps sur le plateau. Dès la Comédie-Française j’ai toujours fait peindre mes cages de scène en blanc. Je n’allais pas peindre la Cour d’honneur tout en blanc ! Mais le plancher ça a été mon premier geste : le peindre entièrement en blanc. Et puis j’ai beaucoup écrit sur le mur de la Cour du Palais des Papes, notamment dans mon texte qui s’appelle Avignon à vie, qu’on avait fait dans la Cour d’honneur avec Denis Podalydès en 2013. Mon idée c’est que : il ne faut pas faire le malin avec la Cour. Ce que j’ai toujours détesté dans la Cour ce sont les décors. J’ai toujours trouvé qu’ils étaient superflus. Ce mur-là est la façade nord de la Cour du Palais des Papes, entièrement refaite par Viollet-le-Duc. La construction du palais s’est faite dans les années 1300 jusqu’à la révolution, et à partir de la révolution il y a eu la destruction de tout un ensemble de choses, un manque d’entretien… L’armée s’installe, commet des réparations comme ils disent « irréparables », ils restent 100 ans… Au bout d’un moment on vire l’armée, et là c’est très beau, il y a des photos magnifiques où il y a tous les chevaux de l’armée qui sont dans la Cour, prêts à partir. Et ensuite ils ont muré toute la partie de la fenêtre de l’Indulgence, et ils ont ouvert tout un tas de fenêtres sur différents niveaux qui ne correspondent pas à celui de maintenant. Quand Viollet-le-Duc est revenu faire une sorte d’état des lieux, ils ont décidé de démurer tout ce que l’on voit dans la Cour. Ça date de 1909-1911, c’est très récent. Donc on a une façade médiévale et on a Viollet-le-Duc qui fait de nouvelles constructions. Les seules choses qui sont d’origine ce sont les larmiers qui sont au-dessus des fenêtres et qui permettent à l’eau de ne pas entrer dans la partie des huisseries. Donc ils ont remuré les fenêtres, réouvert la façade. On est face à quelque chose qui n’est pas originel et qui est un rêve du 19e siècle, un gothique flamboyant refait avec des mouchettes… Tout ça est déjà un décor en soi, toutes les mises en scènes que j’ai vues dans la Cour d’honneur, à part celle de Pina Bausch et celle de Roméo Castellucci (NDLR : la prochaine création française de Pascal Rambert, Trois énonciations est une collaboration avec Roméo Castellucci).
La Cour d’honneur j’ai regardé ça comme un objet en soi. Pour moi le mur de la Cour d’honneur c’est un ready-made. Il n’y a surtout rien à faire. Et quand on travaille avec Yves Godin, qui fait des lumières magnifiques, il fallait faire un plancher blanc pour que les corps, les chaises, les mobiliers, ressortent comme des arrêtes presque graphiques. Le premier spectacle que j’ai vu à la Cour d’honneur c’était Nelken, je ne pouvais pas faire autre chose que traiter mon sol parce qu’en fait il faut toujours traiter son sol au théâtre, parce que c’est la première chose sur laquelle on est, c’est ce qui tient à l’acteur.
![]() Architecture est une logorrhée : vos acteurs parlent beaucoup et en même temps ils ne font que parler de la perte du langage. Pourquoi vous intéressez-vous à la perte des mots ?
Architecture est une logorrhée : vos acteurs parlent beaucoup et en même temps ils ne font que parler de la perte du langage. Pourquoi vous intéressez-vous à la perte des mots ?
Comme disait Antoine Vitez, quand j’étais élève à Chaillot en 1982, dans une course en athlétisme il y a toujours le groupe qui court devant et celui qui se trouve derrière. Alors qu’on croit qu’il est dernier, en fait il a toujours un coup d’avance. J’adore cette métaphore. Je trouvais que faire la Cour sans vidéo, sans musique à fond, sans un jeu outrancier, sans des maquillages incroyables, je trouvais que c’était moderne. Ceux qui peuvent y voir une forme de théâtre classique s’y trompent ! C’est tellement le contraire de ça. Tu rentres sur le plateau, tu vois bien qu’il y a un traitement de l’espace. Olivier Py dans Le Roi Lear développait aussi cette question post-Auschwitz : est-ce qu’on peut continuer de parler, de faire de la poésie ? Avoir un doute vis-à-vis du langage c’est normal. Godard disait faire un film c’est réfléchir au cinéma, ou s’attaquer à lui. Et moi-même quand j’écris j’attaque aussi le théâtre. Ce sont des pièces verbalisées. Je suis obligé de mettre en crise ce langage-là. La façon dont les personnages parlent, le style, comment on va de plus en plus vers une forme d’épure, raconte cela aussi. Il y a une évolution dans la langue, au début elle est fleurie… C’est un spectacle de trois heures et demies, c’est un texte contemporain qu’il faut lire un peu avant car il met du temps à être assimilé.
![]() Comment avez-vous écrit ce texte ? Il y a une impression de mitraillette, est-ce que c’est venu très vite ?
Comment avez-vous écrit ce texte ? Il y a une impression de mitraillette, est-ce que c’est venu très vite ?
En 2014, quand je faisais des répétition à Gennevilliers pour le Festival d’automne, le soir de la dernière j’ai dit à Denis, Emmanuel, Audrey et Stanislas que j’avais envie d’écrire quelque chose, ça s’appelle Architecture. Et puis après j’ai fait Argument avec Marie-Sophie. Donc après les autres je les ai accumulés dans Architecture, puis après ça a commencé à se faire avec le festival d’Avignon. Ils ont commencé à me dire « alors qu’est-ce qu’il se passe ? » On devait le faire à l’Opéra, puis finalement on le fait plus à l’Opéra puis on va le faire à la FabricA puis finalement, comme le projet de Katie Mitchell n’a pas eu lieu, ça s’est fait à la Cour. J’y pense depuis 2014, depuis je me dis « je ferais bien ça avec ces acteurs » puis je me suis mis à écumer les acteurs. Oui je pense d’abord aux acteurs avant le texte. Par exemple, là je pars à Mexico car je prépare une pièce pour le mois de février et que j’écris pour les acteurs. Mais quand j’arrive sur place, je n’ai pas d’idée, je demande à rencontrer des dizaines d’acteurs, je les rencontre individuellement, je parle avec eux. Et quand je reprends l’avion, je fais le squelette de la pièce. Je la vois. Parce que je vais choisir telle actrice ou ce jeune acteur, et le projet naît dans l’avion. Je mets mon masque de sommeil dans l’avion et j’arrive à Paris, le spectacle est fait. Et Architecture, c’est pareil. C’est en un jet, celle-là je l’ai écrite en 20 jours. Je rumine, et j’ai commencé à rédiger à peu près vers mars 2018 et j’ai fini un an après. Donc c’est pas vraiment 20 jours. Mais je déteste les pièces trop scénarisées. Pour moi c’est la langue qui conduit, c’est-à-dire c’est le corps des acteurs, c’est leur énergie.
Mes journées sont très simples, je me lève tôt, je fais une heure de yoga peu importe où je suis, tous les jours depuis des années, et après je commence à écrire et après je pars en répétitions. Donc voilà ; c’est réglé très sérieusement. J’ouvre mon ordinateur et ça part. Ça commence par « tu te prends pour qui ? », ça c’est le début d’Architecture. « Je suis venu te voir pour te dire que ça s’arrête », ça c’est le début de Clôture de l’Amour. À partir de ce moment là, j’ai une sensation… c’est à dire j’ai l’impression d’être un dog walker, un meneur de chien comme à New York. Parce que c’est la langue qui me conduit, ce n’est pas moi qui conduit le projet.
Tout ce que je raconte dans Architecture est vrai, historiquement, même s’il peut y avoir certaines interprétations. C’est très important pour moi et pour toutes mes pièces. Je lis beaucoup, je ne prends pas de notes. Tout est vrai à l’intérieur. Tout a été vérifié comme par un journaliste. Une fois que j’ai accumulé des lectures, des voyages et des rencontres pendant à peu près un an, c’est seulement après que je commence à rédiger et en fait je rédige très très vite. Et ce que j’explique dans Mon cœur mis à nu, je raconte un peu cette sensation que j’ai aussi : j’ai l’impression que c’est comme ceux qui commettent les crimes. J’ai une très longue période de préméditation de la pièce, et après je rédige très vite comme il faut tuer, très vite et très bien. C’est vraiment comme ça que je le ressens. Parfois j’écris entre deux et trois pièces en même temps. Ce que vous appelez une logorrhée, et cela me convient, c’est ma vie. En fait je travaille une phrase depuis 40 ans. Une phrase qui plaît, parfois qui déplaît. Mais c’est la phrase que je travaille.
![]() Est-ce qu’il y a une réelle volonté de faire passer le temps par le Bauhaus car celui-ci revient beaucoup à la mode ?
Est-ce qu’il y a une réelle volonté de faire passer le temps par le Bauhaus car celui-ci revient beaucoup à la mode ?
Il y a un auteur que j’adore qui est Adalbert Stifter. Une écriture extraordinaire. C’est un écrivain de la montagne, de la campagne, des arbres… Il a beaucoup écrit sur le style biedermeier, un style dont on s’est beaucoup moqués, même au niveau de l’écriture, dont Thomas Bernhard s’est beaucoup moqué aussi. Le passage du temps je voulais l’avoir comme ça, à travers le changement d’époque parce qu’au milieu, il y a cet architecte extraordinaire qui s’appelle Adolf Loos, qui a écrit Ornament and Crime, c’est un livre extraordinaire. C’est lui le premier architecte qui commence à théoriser avant le Bauhaus, sur l’épure. Il y a aussi Wittgenstein pour le rôle de Stan, Karl Kraus pour celui de Laurent. Mes inspirations ont été nourries de toutes ces lectures. C’est beaucoup de temps là-dedans et après j’ai arrêté et après j’ai rédigé essentiellement à New-York et à Taipei. J’aime beaucoup faire ça comme ça, très loin.
![]() J’avais l’idée que cette scénographie parlait d’aujourd’hui, ou alors je n’ai rien compris !
J’avais l’idée que cette scénographie parlait d’aujourd’hui, ou alors je n’ai rien compris !
Les ordinateurs qui arrivent à la fin…
![]() Précisons qu’ils sont faux !
Précisons qu’ils sont faux !
Oui ce sont des coques vides.
Ce que l’on peut penser c’est qu’en effet, ce que font beaucoup de jeunes gens au théâtre : un collectif qui est en train de travailler sur cette époque-là comme le font les Chiens de Navarre ou Creuzlvault, et qui a joué une partie de ce spectacle-là, se retrouve ensuite et réouvre leurs ordinateurs en se demandant « bon alors toi qu’est ce que tu as écrit aujourd’hui ? ». Je l’ai moi même fait il y a quinze ans. On travaillait comme ça et on se faisait le point sur ce l’on écrivait quotidiennement. C’est aussi le cas des spin doctors, des gens qui travailleraient sur des scénarios pour en faire un film après.
Il fallait que j’écrive une pièce en créant une tension entre ce moment-là, 1911 jusqu’à l’Anschluss, avec aujourd’hui. Je sais qu’il y a des auteurs qui écrivent sur des sujets d’avant, sur des sujets historiques, mais ce n’est pas ce que je fais. C’est aussi une façon de réfléchir à l’art du théâtre. Je connais assez peu de pièces où on a tant de croisements de voix, ces façons de faire des scènes à neuf, cette façon de dire je suis à Sotchi, je fais un pas je suis à Athènes. Ce sont vraiment des actes théâtraux qui ont l’apparence d’une forme de classicisme. Pourquoi je fais ça ? Je me suis beaucoup intéressé à la biographie de Brecht, pour certains projets. Et je me suis rendu compte que quand Hitler arrive au pouvoir en Allemagne, Brecht part au Danemark pour se réfugier dans une petite maison en dessous de Svendborg. Il y reste à peut près un an et puis l’armée allemande progresse. Il décide de fuir en Suède et part ensuite à Moscou où il prend le Vladivostok, et il arrive à Pékin. Il va voir le grand acteur Mila Fang (l’équivalent de Charlie Chaplin). Et donc il voit là pour la première fois l’opéra de Pékin, une nouvelle façon de faire du théâtre. Dans le théâtre chinois on dit je fais deux pas et c’est le jour qui se lève, et il rapporte ça dans ses pièces. Et c’est ça que j’ai envie de montrer, un théâtre de parole. Plus c’est simple plus ça me plaît. Je fais comme des plans fixes face public de deux actrices qui se tiennent la main, jamais je n’aurais pensé faire ça. Et ça rentre à l’intérieur d’un dispositif qui montre qu’on est dans une chose d’époque qui n’est pas cette époque-là non plus. Si on regarde bien, si on est attentif, on voit bien qu’on est dans une forme d’artefact qui est en cours.
![]() Quelque chose qui m’a touchée particulièrement, c’est la façon que vous avez de poser les corps sur les plateaux. Ce qui m’intéresse ce n’est pas la direction des acteurs, mais comment vous avez dirigé le corps des acteurs ?
Quelque chose qui m’a touchée particulièrement, c’est la façon que vous avez de poser les corps sur les plateaux. Ce qui m’intéresse ce n’est pas la direction des acteurs, mais comment vous avez dirigé le corps des acteurs ?
Pour résumer ce que je veux dire, c’est une question d’énergie et de rapport direct avec les acteurs que je dirige.
![]() Surtout, ils jouent chacun dans leur jeu
Surtout, ils jouent chacun dans leur jeu
Oui ! je pourrais en parler pendant des heures ! Et ensuite c’est quelque chose dont je parle aussi dans ce livre avec Laure Adler, c’est ce que j’ai vu chez Klaus Michael Grüber. Ce que j’ai appris juste en regardant ces spectacles c’est la distance entre deux corps. Et aussi grâce à Pina, qui m’a aidé dans dans sa façon de bouger, avec les axes de déplacements où un acteur est face au groupe dans des diagonales, et tout le théâtre que je fais est né de ces diagonales.
![]() Donc, vous ne dessinez pas ?
Donc, vous ne dessinez pas ?
Non, je mets en scène très très vite et ensuite je fais le cadre très vite aussi, avec les acteurs. Pour ce spectacle j’ai dû faire 12 filages, ce qui est énorme pour la Cour. Je travaille de manière rapide et précise, en sachant directement que tel corps doit être à telle distance. C’est le moment plus agréable de mes répétitions, je ne travaille qu’en direct pendant une dizaine de jours. J’ai tout bâti à Nanterre sur le plateau de Philippe Quesne, j’établis les distances et c’est le moment où je suis le plus heureux. Je ne travaille qu’en direct, j’adore ça.
![]() La Tarentelle, c’est encore autre chose et j’aime bien cette idée de ronde qui vient, justement rassembler les corps, poser le cadre, qui permet de passer à autre chose. Comment est née cette idée de la ronde médiévale, pour le coup ? Pourquoi cette danse-là ?
La Tarentelle, c’est encore autre chose et j’aime bien cette idée de ronde qui vient, justement rassembler les corps, poser le cadre, qui permet de passer à autre chose. Comment est née cette idée de la ronde médiévale, pour le coup ? Pourquoi cette danse-là ?
Oui, j’ai demandé à Thierry Thieû Niang d’assouplir les corps. J’adore les tarentelles et cette danse. Ensuite j’aimais beaucoup le fait que dans les familles, à cette époque là, on se réunissait pour danser, pour faire de la musique ensemble. Il y a donc un aspect historique et puis un aspect, aussi pour les acteurs, de se retrouver. C’est une façon de se rassembler, un accord, le mot accord dit bien ce qu’il veut dire, en se mettant en rond comme ça. Et pour moi ça me semble être essentiel de marier la chose on va dire historique, on se rapproche, on danse, on joue d’un instrument de musique comme on le faisait à l’époque, avec mon spectacle. Ce sont des points de rendez-vous, des rotules, ça tend et ça repart vers ailleurs.
Amélie Blaustein Niddam - Toute la culture - 11 juillet 2019
Voir en ligne : Retrouvez cet article sur le site Toute la Culture