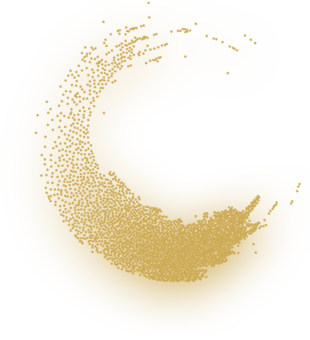Au TNS, Condor ravive les traumatismes du fascisme

Photo : Jean-Louis Fernandez
Deux personnes se font face dans une petite pièce aux allures de prison. Quarante ans après le plan Condor, via lequel les dictatures d’Amérique latine s’associèrent pour exterminer leurs opposants politiques, une ancienne opposante retrouve un bourreau. Anne Théron met en scène ce nouveau texte de Frédéric Vossier sur un plateau cauchemardesque. Dans une incapacité à guérir, les deux personnages incarnent les violences passées et les traumatismes toujours à vifs.
Une femme appelle un homme au téléphone. Ils se connaissent bien, mais ne se sont pas vus depuis longtemps. Frère et sœur, anciennes accointances, ce n’est jamais clairement établi. Anna, c’est son nom, demande à revoir Paul. Celui-ci n’est que moyennement surpris. Ils se retrouvent sur un escalier, en extérieur, mais entrent très vite dans la maison de Paul. Il boit beaucoup d’alcool. Elle a un pistolet dans son sac. Il y a des comptes à régler, mais encore faudrait-il que ces deux individus puissent se parler et se comprendre.
L’imbrication des cellules, un labyrinthe carcéral en guise de plateau
Cela frappe tout de suite : la scène est une cellule de prison, ou une salle d’un complexe militaire. La scénographie élaborée par Barbara Kraft évoque continuellement la dimension carcérale. La demeure de Paul est dépouillée, équipée de rares meubles en métal. Deux haut-parleurs surmontent la scène. Une vitre allongée incrustée dans un mur évoque un bunker et les barrières de métal sur la partie haute du décor ressemblent à des murailles barbelées. Le quartier n’est pas montré, mais toutes ses évocations ramènent à ce même sentiment froid et dégradé.
Il semble qu’autour de la maison ce soit aussi mort qu’à l’intérieur. Seul le centre-ville, lointain, ou la cabane de Paul, racontée au détour d’un souvenir, semblent des refuges. Mais le temps les a rendus inaccessibles. Paul passe quelques moments dans son jardin, qui apparait en fond de scène à travers de larges vitres. C’est un étroit caisson où il contemple le tronc d’un grand arbre, qui lui crève le plafond et surgit à l’air libre. Cet espace, là-encore, fait office de cellule.
Le spectacle est avant tout celui d’Anna. C’est elle qui prend l’initiative d’appeler Paul. Elle est dans l’action, elle vient s’imposer chez lui, le bouscule, le questionne. Mais malgré son allure volontaire, elle subit beaucoup de chocs. Il y a plusieurs passages cauchemardesques qui hantent le spectacle. Des flashs traumatiques apparaissent. Un fusil sur le sol transforme le mur devant lequel il est posé en scène d’exécution. Il y a ce moment où les visions deviennent palpables au point qu’Anna revive son enfermement et ses tortures. En gigantesque, sur le mur du fond, Paul apparait en costume de bourreau, en train de l’interroger et de rire. Puis la vidéo disparait, Paul revient dans la pièce, et Anna reconnecte avec le présent.
Une réminiscence des traumatisme qui semble échouer à les exorciser
Les violences directes sont rares dans Condor. Tout est plutôt dans le symbole, l’évocation et le souvenir. Les mouvements, chorégraphiés par Thierry Thieû Niang, en disent parfois plus que les mots, notamment ceux de Paul. Avec sa voix douce et son corps mince, Frédéric Leidgens donne une impression de calme et de mesure. Il se déplace en glissant, tombant, rebondissant avec une mollesse détachée. Son flegme contraste avec ses mots crus et ses fantasmes de gloire militaire fasciste. Ce contraste apporte un sentiment de menace permanent. Et bien qu’Anna, campée par une Mireille Herbstmeyer droite et solide, semble dominer la plupart des échanges, sa fragilité et la peur gravée en elle par le traumatisme des tortures sont toujours perceptibles.
C’est un spectacle sur l’après, sur les conséquences du traumatisme. Il ne parle pas des devenirs politiques qui ont animé les conflits, mais de ce que tout cela a laissé dans les corps et les esprits des protagonistes. Paul vit dans une prison, un bunker verdâtre où il est enfermé comme dans sa nostalgie. Anna se retrouve à nouveau dans sa prison brésilienne. Elle revient quarante années en arrière et confirme, en face de son bourreau, la réalité de sa tragédie. Lui se montre volubile, accueillant, en paix avec sa conscience malgré les phrases abjectes qu’il aligne. Il n’y a pas de romantisation de ces personnages, pas de vernis héroïque ou horrifique de leur passé. Leur existence est posée d’un bloc devant le public, crue et nette.
Une violence universelle qui sourde au fond de la prison
Les deux personnages, dans le dynamique, résument à eux seuls le fascisme. L’un écrase l’autre avec toute la force, le pouvoir et l’assurance d’une organisation étatique sans scrupule. Les demandes peuvent être humiliantes ou insensées, elles servent à contraindre, à rendre docile. On propose une cigarette, on évoque les proches, on fait tout pour prendre l’entier contrôle de la cible. Puis, après toute cette violence, le bourreau affirme son innocence. Ce qu’il a fait, c’est pour le bien commun, pour le pays. Il ne se considère pas comme un monstre, et ne comprend même pas toute la haine et la rancœur qui habitent sa victime.
La thématique su spectacle est telle qu’il serait aisé de glisser rapidement dans l’explicite ou le visuel. Mais la violence, en soi, n’est pas l’enjeu de la pièce. Elle ne lui accorde donc que sa place de moyen, un outil qui a créé des liens entre les individus et qui a pu changer l’essence même d’une femme. La dynamique des deux personnages est rapidement exposée, par légères touches : le ton d’Anna au téléphone qui exige de venir, Paul sur une marche plus haute qu’Anna ou assis sur sa table, et qui la surplombe. Les éléments les plus évocateurs sont peut-être les deux armes à feu, mais rapidement éclipsées. Elles ne se montrent que pour rappeler jusqu’où va la violence : jusqu’au meurtre.
Le spectacle joue sur des stimuli sensoriels : des flashs lumineux bien sûr, mais aussi du son. Les voix d’enfants qui jouent à imiter des animaux ou la mélodie des vagues semblent au départ anodines. Elles prennent un nouveau sens au fil du spectacle, en se faisant l’écho des tortures de la prison. Cette écriture fine, qui se découvre peu à peu et autorise chacun à faire sa propre lecture, donne paradoxalement encore plus la nausée lorsque, finalement, advient la conscience de ce qui s’est passé, de ce qui a pu se passer dans les cellules brésiliennes. C’est un sentiment glaçant lorsque Paul évoque avec nostalgie ces années passées au service du fascisme, comme d’aimables virées entre copains. Et qu’il se réjouit mollement de voir que, de nos jours, ce régime commence à reprendre du service.
Tristan Kopp - Rue 89 Strasbourg - 16 octobre 2021
Voir en ligne : Retrouvez cet article sur le site Rue 89 Strasbourg